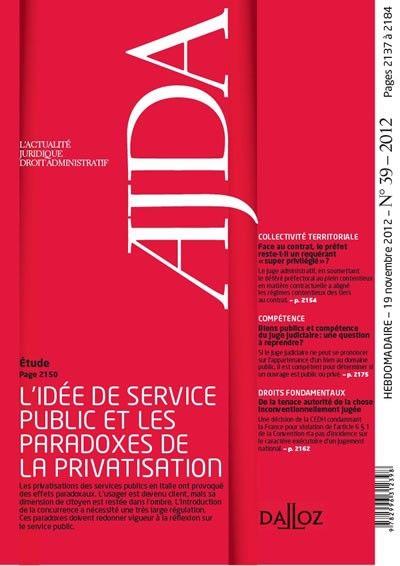AJDA 26/2013
A l'origine l'idée de ce colloque nous est venue naturellement de la date anniversaire du centenaire de cette formidable espèce de 1912 (Conseil d'Etat 31 juillet 1912, « Société des granits porphyroïdes des Vosges » R.909 concl BLUM).
A la réflexion, l'idée de ce colloque vient sans doute plus profondément d'un agacement de voir de jeunes et brillants esprits universitaires se gausser du « droit administratif de papa » pour dénier à la grande période du Conseil d'Etat flamboyant son rôle normatif ou à tout le moins fixateur.
Au final, la « restauration » de ce vieil arrêt a révélé comme toutes les vieilles affaires, son lot d'erreurs de faits comme peut-être de droit.
La découverte grâce aux archives de la ville du cahier des charges du contrat dont s'agit suscite en effet une interrogation sur la qualification juridique donnée par Léon Blum lui-même dans ses célèbres conclusions (Dalloz 1916.3.35) (Un grand merci, en particulier au service des archives de la ville de Lille et à sa responsable, Madame Claire Marie GROSCLAUDE, pour leur disponibilité, et la motivation particulière qu'ils ont mise à retrouver les documents du marché (cahier des charges, procès verbal d'adjudication et délibération autorisant à ester. Un peu de chance a d'ailleurs jalonné cette recherche, puisque normalement les archives de la ville ont brûlé lors de l'incendie de 1916, mais les documents retrouvés ont échappé à cette destruction). Il estimait en effet que « dans l'espèce, il s'agit exclusivement de matériaux commandés et livrés qui, dès leur livraison, sont pris en charge par la ville. Nous n'apercevons donc, dans un marché de ce genre, aucun des caractères du travail public. ».
Les documents retrouvés donnent beaucoup d'informations mais pas nécessairement de solution.
On se souvient que la question jugée par le conseil d'État concernait « un mandat de paiement, en date du 20 novembre 1907, par lequel de maire de Lille a prescrit au receveur municipal de payer à la société requérante, pour le montant de fourniture de pavés faits à la ville, une somme de 147 763,80 Fr., seulement, après déduction de 3 436,20 Fr., représentant la pénalité pour retard dans la livraison. Ce mandat avait établi pour la liquidation d'un marché du 17 novembre 1906, au terme duquel la société avait soumissionné la fourniture à la ville de 1 500 000 pavés de granit » (Conclusions Blum précitées).
De fait l'on retrouve un procès-verbal d'adjudication en date du 17 novembre 1906 (Cf. photo d'archives), concernant « la fourniture des pavés nécessaires à la reconstruction du pavage de diverses voies », mais intitulé très exactement « reconstruction du pavage de diverses voies 1er lot - fourniture de pavés des Vosges. »
Le procès-verbal de réception en magasin, daté cette fois du 31 décembre 1907 (cf. photo d'archives) accuse réception des pavés dans le cadre de l'adjudication du 17 novembre 1906 intitulé « 1er lot - fourniture de pavés des Vosges ».
Un rapport de Monsieur le maire demande et obtient l'autorisation d'ester contre la « Société des granits porphyroïdes des Vosges », constatant que « cette fourniture devait être faite à raison de 180 000 pavés par mois, faute de quoi une retenue de 5 % de la valeur des fournitures en retard serait opérée sur les sommes dues à l'entrepreneur. Le 12 mai 1907, le nombre de pavés fournis n'étant que de 529 100, alors qu'il devait être de 720 000, l'administration municipale mis à plusieurs reprises en demeure l'adjudicataire de se conformer aux clauses du cahier des charges.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, un arrêté infligeant une retenue de 3436,60 Fr. fut pris le 13 juin 1907.
La Société des granits porphyroïdes des Vosges contestant la légalité de cet arrêté par la voie du recours pour excès de pouvoir, nous vous prions de nous autoriser à défendre cette action. »
Pour autant la lecture du cahier des charges (cf. photo d'archives), en son article premier démontre que le « marché » comprenait quatre objets : un point 1° « de travaux de démolition de pavage... », un point 2° de « fourniture et la mise en place des scories, cassons de briques ou ballast nécessaire à l'établissement de la nouvelle forme », un point 3° de « fourniture » à pied d'oeuvre du sable nécessaire au pavage » et un point 4° « apport des pavés neufs, du lieu de dépôt au chantier. »
Si incontestablement les points trois et quatre ne sont pas la marque d'un marché de travaux, les deux premiers au moins le sont à l'évidence.
À la lecture de ces documents incontestables, l'on est en droit de se poser la question de savoir si l'on était en présence d'un litige relatif à un marché de travaux publics ou à un simple contrat de fourniture. On sait que Léon BLUM et le Conseil d'Etat optèrent pour la deuxième solution.
L'enjeu, en termes de compétences était essentiel, un litige concernant un marché de travaux publics relevant, en vertu de la loi du 28 Pluviôse an VIII (L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et de l'administration attribuait compétence aux Conseils de préfectures pour se prononcer notamment "sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leur marché".L'article 7-IV de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques a abrogé cet article de la loi, mais le principe de compétence reste naturellement), d'une nécessaire compétence administrative. On sait que l'arrêt du conseil d'État détermina l'incompétence de la juridiction administrative, en suivant la qualification juridique proposée par Léon Blum d'un simple marché de fournitures, sur lequel la haute juridiction et la doctrine postérieure grefferaient la théorie de la non exorbitance pour justifier la seule compétence judiciaire.
La question a été posée très précisément lors de ce contentieux puisque la ville elle-même défendait la compétence de la juridiction administrative, au motif de la présence d'un marché de travaux publics :
« Suivant la ville, le marché dont il s'agit, aurait été à tort qualifié par le contrat même de marché de fournitures ; il s'agirait, au contraire, d'un marché de travaux publics, la fourniture dont il s'agit n'ayant été que l'accessoire de travaux publics de pavage entrepris par la ville de Lille et auxquels, d'après les termes de l'article 1er du cahier des charges, les pavés fournis étaient exclusivement destinés. Par application de la loi de pluviôse, le conseil de préfecture aurait donc compétence exclusive. » (ibidem).
Le commissaire du gouvernement allait balayer cette qualification juridique et abonder dans le sens de la « Société des granits porphyroïdes des Vosges » en les termes suivants :
« Et, après examen du cahier des charges, nous estimons que, sur ce point, la réponse de la société requérante est topique. On se rend compte, en effet, par la lecture du contrat, qu'il vise exclusivement la fourniture. Les pavés commandés à la société sont amenés par elle à Lille. Ils sont déchargés à quai et étalés sur le terre-plein, où il est alors procédé à leur examen et à leur réception. Les pavés jugés défectueux et rebutés sont enlevés par l'entrepreneur, mais la ville prend livraison sur le quai même des pavés reçus. C'est elle, à dater de ce moment, qui les prend en charge. C'est par ses soins que sont opérées toutes les manutentions et tous les travaux ultérieurs. »
Cette affirmation contredit pourtant apparemment la lettre même de l'article premier du cahier des charges qui rappelle que
« l'entreprise a pour objet :
1° les travaux de démolition de pavage des chaussées existantes, de terrassement, d'enlèvements de vieux pavés et des déblais de l'ancienne forme ;
2°la fourniture et la mise en place des scories, cassons de briques ou ballast nécessaires à l'établissement de la nouvelle forme »
Seul le 3° évoque la fourniture de sable, et le 4° précisément « l'apport de pavés neufs, du lieu de dépôt au chantier ».
Ainsi, quand Léon Blum indique qu'après « examen du cahier des charges » (sic), et à la « lecture du contrat », ce dernier « vise exclusivement la fourniture », l'on ne peut que s'interroger.
A-t-il réellement lu le cahier des charges, qui pourtant est sans ambiguïté en son article premier ? L'importance du nombre de contentieux jugés par peu de personnes à cette époque-là au conseil d'État, pourrait expliquer une lecture rapide, par exemple limitée aux documents officiels du marché. Il est vrai que le procès-verbal d'adjudication en date du 17 novembre 1906 évoque clairement la « fourniture de pavés des Vosges », que le procès-verbal de réception en magasin du 31 décembre 1907 est précisément un simple procès-verbal de... réception, et surtout que la demande d'autorisation d'ester du maire de Lille n'évoque effectivement qu'une prestation de fournitures mal exécutée et justifiant une retenue de 3336,60 Fr. Cela signifierait-il que alors qu'il affirme expressément avoir lu le cahier des charges, notre célèbre commissaire du gouvernement et futur président du conseil serait en situation d'instruction insuffisante du dossier? On peut douter de cette hypothèse, dans la mesure où Léon Blum évoque expressément le cahier des charges qui avait nécessairement été produit dans les écritures de procédure.
Une autre explication, plus technique mais qui mérite un examen approfondi, serait celle du recours implicite à la qualification juridique de l'allotissement et donc à la divisibilité du marché en plusieurs lots, dont seule le quatrième (la fourniture) selon Blum si cette explication s'avérait juste, était présentée au conseil d'État. Un certain scepticisme pourrait trouver argument, à propos de cette hypothèse, dans le fait qu'à aucun moment, dans ses conclusions, Léon Blum n'évoque le terme de «lot ». Plus encore il évoque expressément l'article premier du cahier des charges, dont il a déjà été vu qu'il comprenait quatre missions, dont les deux premières étaient assurément des prestations de travaux publics, ce qui signifierait alors que Léon Blum aurait entendu donner un cadre de litige strictement limité à un « lot » de seule fourniture. Sans le préciser, sans le justifier ? On peut en douter et l'on pourrait également associer cette deuxième hypothèse (celle de la qualification et de la division en lots du marché), à la première (l'insuffisante instruction) en reprenant les intitulés des procès-verbaux : il est vrai que le procès-verbal d'adjudication en date du 17 novembre 1906 évoque un « 1er lot -fourniture de pavés des Vosges » et que le procès-verbal de réception magasin du 31 décembre 1907 évoque lui aussi la même formulation à propos d'ailleurs expressément de cette adjudication du 17 novembre 1906. Dans la mesure où le procès-verbal d'adjudication, qui constitue le document essentiel évoque un titre complet ainsi libellé « reconstruction du pavage de diverses voies, 1er lot - fourniture de pavés des Vosges » on pourrait penser que les rapporteurs de ce dossier avaient peut-être considéré que le litige portait en fait sur le premier lot d'un marché de reconstruction certes, mais que ce premier lot ne concernait que la fourniture et qu'il devait donc être détaché du marché global.
Cette hypothèse bienveillante à l'égard du rapporteur et du commissaire du gouvernement se heurte quand même aux termes utilisés par Léon Blum dans ses conclusions : il évoque on le rappellera le cahier des charges dans sa globalité de l'article premier, c'est-à-dire les quatre prestations, dont on considérerait qu'il s'agit de quatre lots. D'autre part Léon Blum évoque la « lecture du contrat ». Quel contrat ? Car le contrat, comme le révèle le procès-verbal d'adjudication est un contrat de « reconstruction de pavage », et donc un contrat correspondant un marché de travaux publics. Il y a donc nécessairement une « erreur », au moins dans la terminologie utilisée dans les conclusions.
Encore une fois l'absence formelle du mot « lot » laisse perplexe et une troisième hypothèse nous semble plus crédible et relèverait de la célèbre méthode dite de l'inversion, selon laquelle la haute assemblée déterminerait en premier lieu la solution juridictionnelle qu'elle juge opportune, et dans un second temps opèrerait une qualification juridique permettant d'y arriver. Ce type de raisonnement est un grand classique des arrêts fondateurs de critères. Ainsi le célèbre arrêt société le Béton de 1956 (Conseil d'Etat 19 octobre 1956 Société Le béton, RDP 57.310 concl. Long) par exemple part sans doute d'une volonté - après instruction en « intime conviction » - de priver la société commerciale le Béton du bénéfice de la propriété commerciale lors de son éviction, ce qui nécessitait l'incorporation au domaine public, et a donc justifié la création du concept d'aménagement spécial (en cette espèce d'ailleurs lié au seul emplacement de l'immeuble de la société le Béton). Le même raisonnement se retrouve dans le célèbre arrêt ville de Toulouse en 1961 où l'on peut penser que pour permettre l'exercice d'un droit de résiliation par la commune du contrat d'occupation du stade, il fallait que ce contrat fût administratif, et pour qu'il le soit il fallut au conseil d'État considérer qu'un stade de 30 000 places assises avec équipements luxueux était affecté.... au sport scolaire et municipal (Conseil d'Etat 13 juillet 1961, AJ 61.467, et pour un commentaire critique de l'affectation réelle du stade, voir Manuel GROS, l'affectation critère central de la domanialité publique RDP 92 page 761) ! En l'espèce on ne peut s'empêcher de penser, compte tenu à l'époque d'un risque de très nombreux contentieux liés au développement des villes et la création de nouvelles voies, comme à Lille, que la haute assemblée, avec comme porte-parole Léon Blum, ne souhaitait pas « récupérer » la compétence par rapport à ce type de contrat
En d'autres termes, et plus simplement, il ne fallait pas, au travers de cette espèce essentielle et susceptible d'être un précédent, que le juge administratif soit compétent. Il était donc impératif de ne pas y voir un marché de travaux public. Dans ces conditions, le commissaire du gouvernement ne pouvait alors qu'accepter de voir le côté fourniture du marché et écarter ou ne pas avoir vu le côté marché de travaux publics. S'ouvrait alors une avenue dans laquelle pourrait se construire la théorie de la clause exorbitante du droit commun, ou plus exactement la théorie de la non exorbitance relevant un comportement contractuel « selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ».
L'opportunité d'un désengorgement du conseil d'État, à l'époque juge essentiel de l'ensemble du contentieux administratif, pourrait bien donc n'être pas absente dans cette « erreur » ou dans cet aveuglement partiel de Léon Blum et du conseil d'État lui-même, pour écarter, selon les termes mêmes de l'arrêt la qualification du marché en travaux publics (« considérant que le marché passé entre la ville et la société était exclusif de tous travaux à exécuter par la société et avait pour objet unique des fournitures à livrer... »)
Ainsi ce premier membre du considérant qui est objectivement faux au regard du cahier des charges a permis la deuxième partie du considérant (« ...selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ».), qui allait permettre la naissance d'un critère du contrat administratif, le célèbre critère matériel de l'exorbitance.
Les petites causes ont souvent de grands effets, les erreurs des grands juristes se transforment souvent en opinion doctrinale originale.
Peu importe au fond, puisque cette jurisprudence a contribué à fixer d'une certaine manière l'autonomie du droit administratif.
Comme dit le cardinal de Mazarin, dans un célèbre roman de Dumas (Vingt ans après- tome II), à propos de d'Artagnan ayant commis l'erreur d'écraser le conseiller Broussel, leader populaire, lors de la Fronde: « Ce qui me console, dit-il, puisque d'Artagnan l'a manqué, c'est qu'au moins en courant après lui il a écrasé Broussel. Décidément le Gascon est un homme précieux, et il me sert jusque dans ses maladresses. »
On peut donc à ce titre remercier Léon Blum de son erreur (Pour terminer sur une pirouette, l'erreur de Léon BLUM , fondatrice du droit administratif porte sur une erreur elle-même, puisque certains ont qualifié eux mêmes l'article 4 de la loi de Pluviôse an VII d'erreur de plume fondatrice du droit administratif (G. Guglielmi, "L'article 4 de la loi, une erreur de plume, fondement du droit administratif ?", La loi du 28 pluviôse an VIII deux cents ans après: survivance ou pérennité ?, Paris, PUF, 2000, p. 199-215)).
Elle n'a en tous les cas pas empêché l'intérêt des interventions et débats issus de ce colloque d'un jour, dont les actes qui suivent se veulent la restitution.
Manuel GROS
Professeur à l'Université de Lille2
Doyen honoraire de la faculté Alexis de Tocqueville